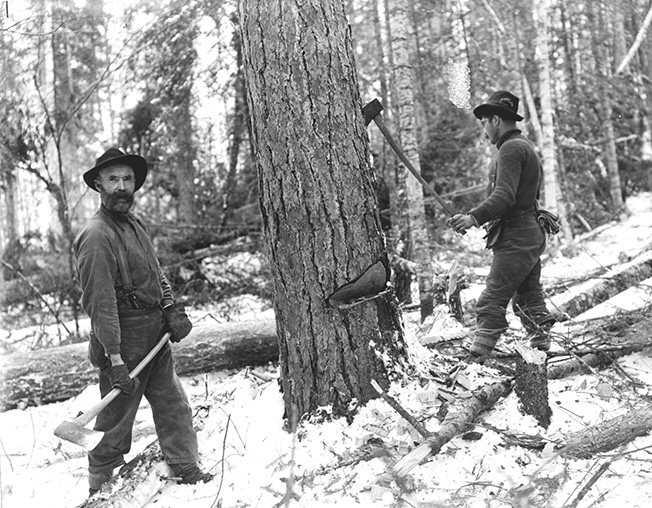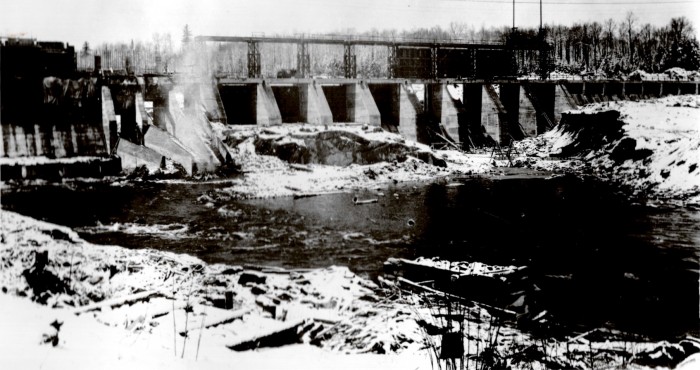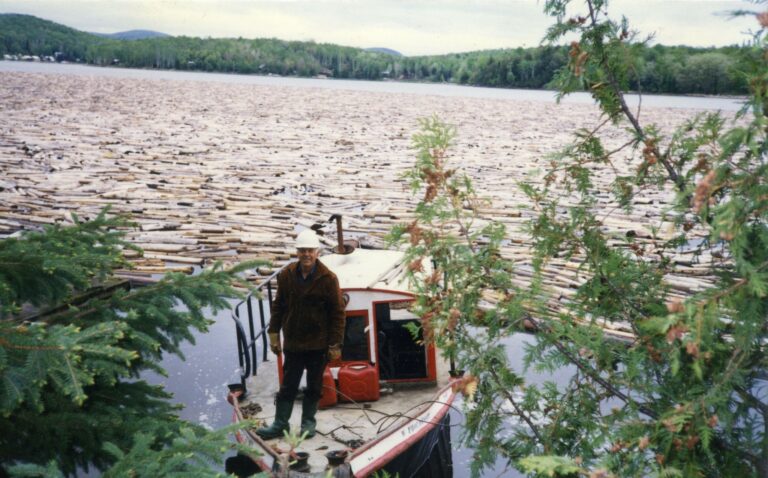Avec ses montagnes, ses falaises, ses îles et son immense plan d’eau, les paysages du Parc régional du Poisson Blanc, situé à Notre-Dame-du-Laus (NDL), font le plaisir de bon nombre d’aventuriers. Depuis la création du Parc en 2008, la Corporation du Parc du Poisson Blanc assure leur protection et leur mise en valeur à des fins écotouristique. Elle incite ceux et celles qui s’y trouvent à pratiquer des activités récréatives de manière respectueuse de l’environnement.
Derrière ces paysages enchanteurs se trouve une histoire riche en récits. Afin de vous faire découvrir comment il se sont façonnés, voici une brève histoire à rebours qui décortique couche par couche les pratiques et les personnages qui ont participé au développement de la région.